
Les pharmaciens dans la Grande Armée
Un tableau général dressé en décembre 1799 décrit 2307 officiers de santé. L'état numératif des officiers de santé employés aux armées et à l'intérieur du 25 ventôse de l'an 9 (16 mars 1801) décrit 665 pharmaciens, 1289 chirurgiens et un total de 2199 personnes en service. Une répartition selon les origines géographique en janvier 1801 est ainsi décrite :
| Lieux | Pharmaciens | Chirurgiens | Médecins |
| France intérieur | 221 | 368 | 116 |
| Italie | 150 | 385 | 37 |
| Grisons | 31 | 54 | 5 |
| Rhin | 197 | 352 | 49 |
| Pays-Bas | 32 | 50 | 13 |
| Corse | 23 | 33 | 7 |
| Total :2123 | 654 | 1242 | 116 |
Ce chiffre décroît spectaculairement pour atteindre 170 pharmaciens actifs en 1802 conséquence des licenciements massifs liés à la paix continentale mais rapidement avec la guerre qui revient la croissance reprend avec 306 pharmaciens en 1804. 
Le recrutement subit essentiellement deux périodes critiques, la première pour la campagne d'Allemagne et d'Autriche (1805) et la seconde pour la campagne de Russie (juin à décembre 1812).
Ainsi Larrey propose le 17 fructidor an 13 (4 septembre 1805) une solution pour compléter les effectifs de cadres "pour subvenir aux besoins urgents du service de santé, pour avoir les médecins et les pharmaciens en nombre suffisant, à l'effet de compléter les cadres, approuvés par le ministre Directeur de l'Administration de la guerre, le soussigné a l'honneur de proposer à son Excellence les dispositions suivantes :
"écrire une circulaire à MM les préfets du département pour qu'ils invitent les médecins, chirurgiens et pharmaciens de leur arrondissement qui auraient déjà servi et qui désireraient servir encore, à envoyer leurs noms, prénoms, âge, époque de leur entrée en service, de leur licenciement, avec indication des grades qu'ils auraient eu, des lieux ou des armées où ils auraient servi ; s'ils ont continué d'exercer dans les hôpitaux civils, soit autrement, s'ils exercent encore..."
Les Officiers de santé retournés à la vie civile ne manifestent qu'un enthousiasme très limité pour bénéficier d'une "commission temporaire" d'autant plus que les soldes proposées ne sont guère alléchantes. Globalement, le remplacement des cadres est réalisé par l'avancement des subalternes considérés comme les plus compétents.
Larrey confie ses inquiétude au sujet des pharmaciens dans une lettre en 1805 "Quant aux pharmaciens ce n'est ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux civils qu'il faut aller les chercher... il a fallu à cet effet prendre des avis indirects chez les Maîtres de la capitale et il ne fallait pas moins que le zèle bien entendu du doyen de cette partie, de M. Parmentier premier pharmacien des armées et présentement l'un des inspecteurs Généraux du service de santé pour satisfaire aux besoins, à toutes les époques difficiles où l'on s'est retrouvé depuis 15 ans et plus. on pense donc qu'il serait indispensable de rappeler ici deux Inspecteurs Généraux où leurs lumières et leur expérience seraient infiniment plus utiles que partout ailleurs".
La réquisition est une pratique issue de la Révolution. Elle est presque abandonnée pour les sujets de nationalité française (sauf Michel Baldus, Antoine Barry, Nicolas Dumont et Antoine Sommerfogel). cependant, elle continue à fonctionner pour les pharmacien de nationalité étrangère.
C'est essentiellement le système des commissions qui est en vigueur, il est basé sur la motivation ou au moins le volontariat.
En effet, l'article 152 de l'Instruction générale, ne prévoir aucune exemption de conscription pour les étudiants des Écoles et Facultés de médecine et pharmacie. Les jeunes gens de vingt ans doivent tirer un numéro au sort et s'il est désigné, il est enrôlé comme soldat. Ce tirage au sort explique que la forte majorité des élèves en pharmacie qui demandent à subir les examens d'entrée dans le service de santé le font avant 20 ans. En effet, ils préfèrent être dans l'armée comme pharmacien, Officier de santé, que comme simple soldat.
L'admission dans le service de santé fut inspiré en partie par le désir d'échapper à la conscription peu enviée par la bourgeoisie, mais il ne faut pour autant pas négliger l'élan patriotique dans ces périodes troublées et l'intérêt qu'a dû susciter la vie guerrière pour ces jeunes gens.
Il existe une population non négligeable de recrutés, environ un tiers, qui sont des jeunes gens libérés de la conscription car ils n'ont pas été tirés au sort mais qui deviennent pharmacien des armées de leur propre chef comme Emile Agée, Auguste Andrieux, Pierre Beaunier, Jacques Clevenot, Joseph Grimal, Jean Laboulbène, Victor Legendre ou Isidore Mallez. Cette action est tout à leur honneur car ils n'avaient aucune obligation de rentrer dans l'armée ce qui prouve l'élan patriotique et le dévouement de leur part.
Pour la campagne de 1805 où le recrutement avait été le plus difficile à organiser, les jeunes gens qui avaient suivis leurs études dans les écoles d'Instruction des armées en étaient sortis depuis la fermeture définitive en l'an 10 (1802) et étaient alors passés sous-aides dans les hôpitaux militaires.
Ces pharmaciens constituent une partie du contingent mais ne suffisent pas. Les années creuses où n'ont pas été formés d'élèves destinés à la carrière militaire par simple mesure d'économie, cet apport ce fait cruellement sentir.
En 1812 pour la campagne de Russie, le chiffre de pharmaciens devient très élevé avec 1011.
Du fait des conditions de recrutement décrites précédemment, ce sont de jeunes gens comptant en moyenne trois ans d'études qui sont admis dans les armées.
Bayen et Parmentier dans une lettre du 28 floréal an 4 avaient insisté sur le fait que " les études pharmaceutiques au terme de la loi, doivent avoir été d'au moins d'une année, point essentiel qu'il faudra vérifier".
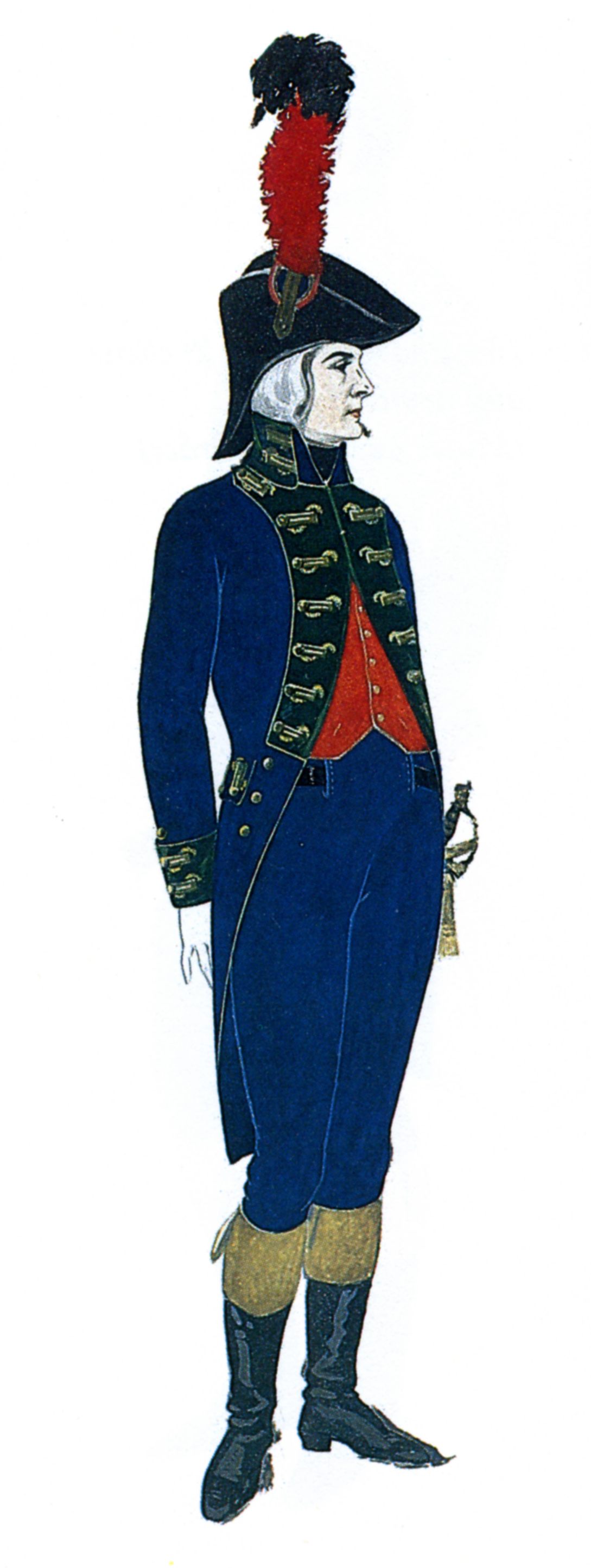 Pour les hôpitaux militaires d'instruction, les élèves étaient admis après un examen où ils devaient faire la preuve des études qui conduisaient aux sciences physiques, de quelques connaissances élémentaires dans l'art de guérir et de deux ans de service au moins dans les hôpitaux militaires. Ainsi, après trois ans d'étude dans les hôpitaux d'instruction, ils pouvaient être nommés sous-aides.
Pour les hôpitaux militaires d'instruction, les élèves étaient admis après un examen où ils devaient faire la preuve des études qui conduisaient aux sciences physiques, de quelques connaissances élémentaires dans l'art de guérir et de deux ans de service au moins dans les hôpitaux militaires. Ainsi, après trois ans d'étude dans les hôpitaux d'instruction, ils pouvaient être nommés sous-aides.
Si les connaissances ne manquent pas aux jeune recrues, l'expérience des hôpitaux des armées n'est pas suffisante. Ils sont jeunes et inexpérimentés mais globalement les notes figurant dans certains dossiers font état des connaissances, du zèle et du dévouement des pharmaciens.
Les jeunes gens qui désirent être employés adressent leur demande au ministre Directeur de l'Administration de la guerre qui la transmet aux Inspecteurs Généraux. Pour la pharmacie militaire c'est Parmentier qui décide seul.
Le candidat se présente alors à l'Inspection, ou, s'il habite en province chez le maire, afin de remplir sa fiche de candidature et de réponde aux questions écrites qui lui sont posées. Les inspecteurs inscrivent sur des listes les noms des admis et adressent les documents au bureau du personnel.
C'est le Ministre qui commissionne, c'est-à-dire qui met en "activité" les pharmaciens car les Inspecteurs n'ont qu'un rôle consultatif.
Fée qui fut nommé pharmacien-sous-aide à l'armée d'Espagne le 7 novembre 1809 note dans ses mémoires le récit amusant de cet examen "telle était la pénurie dans laquelle on se trouvait pour recruter les Officiers de santé qu'on se dispensait d'exiger d'eux des examens,. Il suffisait de répondre par écrit à des questions élémentaires et l'on été reçu. Appelé au ministère de la guerre pour remplir cette formalité.." Il remplit également la copie d'un élève chirurgien qui fut reçu....
Quelques mesures sont prises pour éliminer les incapables ainsi le 23 mai 1812 une note est adressée aux Inspecteurs généraux émanant du bureau du personnel du ministère de la guerre pour leur faire connaître " qu'à l'avenir, l'aptitude d'un officier de santé a être employé dans un grade quelconque devra être reconnue après délibération des Inspecteurs généraux fixés au nombre de trois au moins, dont un au moins, sera nécessairement de la profession du candidat".
Le décret du 3 ventôse an II il est noté "Des cours d'instruction seront établis dans les hôpitaux dont la position paraîtra convenable, d'après l'avis motivé de la Commission de Santé et les ordres du Conseil exécutif provisoire " (Gama p321). Il s'agit probablement des hôpitaux de Lille, Metz, Strasbourg et Toulon car on les retrouve dans le règlement du 30 floréal an IV avec l'additif du Val de Grâce.
Une loi du 14 frimaire an III établit à Paris, Montpellier et Strasbourg des Écoles de Santé, "destinées à former des Officiers de Santé pour le service des hôpitaux et spécialement des hôpitaux militaires et marine."
L'école de Paris devait être placée "dans le local de la ci-devant Académie de Chirurgie, auquel on réunira le ci-devant couvent des Cordeliers".
Ainsi 300 élèves étaient prévus à Paris, 150 à Montpellier et 100 à Strasbourg. Les cours devaient être ouverts au public en même temps qu'aux élèves. Des exercices pratiques "dans les hospices voisins des écoles" étaient prévus. Après trois années d'étude payées les élèves étaient appelés au service des hôpitaux des armées.
Selon JP Gama "ces études ne prospèrent pas comme institution appartenant à l'armée, mais elles persistèrent sous le nom d'école de santé pour toutes les études médicales avec un mode d'enseignement public, jusqu'à l'établissement des Facultés de médecine actuelles. Les hôpitaux de metz, Lille et Strasbourg continuèrent seuls à former des élèves destinés à l'armée" (p320).
Un règlement du 5 vendémiaire an V sur "l'enseignement et l'art de guérir dans les hôpitaux militaires" prévoyait des cours d'instruction dans les hôpitaux militaires de Lille, Metz, Strasbourg, Toulon et Paris. Chacun de ces hôpitaux devait comprendre, promu au rang de "professeur", un "pharmacien en chef choisi de préférence parmi ceux qui auront été employés en chef dans les armées" et un pharmacien de 1ère classe ". Ils ne devaient faire que les cours dont ils étaient officiellement chargés et ne pouvaient recevoir aucun salaire pour leçon particulière.
Ils devaient en temps de paix, être nommés sur concours, ouverts aux seuls pharmaciens militaires de 1ère classe ayant trois ans d'exercice dans cette fonction, mais en réalité " le concours pour le professorat n'a jamais eu lieu parce qu'il était remis à la paix générale dont on n'a eu un moment que l'apparence. Les nominations de professeurs furent donc faites directement" (JP Gama p358).
Les cours de pharmacie portaient sur "l'histoire naturelle des médicaments du règne minéral, du règne végétal et du règle animal" pour le pharmacien en chef et sur les opérations pharmaceutiques pour le pharmacien de 1ère classe.
L'enseignement se dégrada durant l'Empire : l'arrêté du 24 thermidor an VIII prescrit une diminution du nombre des professeurs et le remplacement des hôpitaux d'instruction de Paris et de Toulon par celui de Rennes.
Le règlement du 9 frimaire an XII supprime les hôpitaux d'instruction et déclare de façon très discutable que les Inspecteurs Généraux doivent faire des cours publics durant leurs missions d'inspection. Devant cette situation défectueuse, une circulaire du 3 frimaire an XIII précise l'intention du Gouvernement qui est "que l'on s'occupe dans les hôpitaux militaires de l'Empire de l'instruction des élèves qui y sont employés".
A la fin de l'Empire, la situation de l'enseignement de la pharmacie militaire est critique car les cours sont fréquemment interrompus pendant les guerres très fréquentes.
Lorsqu'il s'agit de mobilisation, les pharmaciens reçoivent leur lettre de service soit au bureau du ministère de la guerre s'ils sont à Paris, soit à la mairie de leur commune.
ils signent alors un récépissé et partent pour la destination qui leur est assignée. Ils sont obligés de suivre le trajet imposé par leur feuille de route qu'il leur faudra faire signer par les commissaires aux différentes étapes.
A leur arrivée à leur poste, ils font signer leur extrait de revue aux commissaires aux guerres, puis se présentent à leur chef hiérarchique.
En fonction des besoins fixés par l'Intendance, le Ministre invite les Inspecteurs généraux donc Parmentier pour les pharmaciens jusqu'à son décès en 1813 puis ce sera Laubert à donner leur avis puis le Minsitre nomme les Officiers de santé au grade supérieur. Il arrive parfois que l'Intendant Général prenne cette décision à titre provisoire.
Références :
Thèse de Sylvie Oullieux . "contribution à l'histoire de la pharmacie : les pharmaciens de la Grande Armée" université Claude Bernard Lyon I, 5 décembre 1986.
Thèse de Jean-Paul Gilli. "La pharmacie militaire sous la Révolution et l'empire" université de Paris, 3 novembre 1959.
Jean-Pierre Gama. "Esquisse historique du service de santé militaire en général et du service des hôpitaux en particulier" Paris 1841.
Francis Trépadoux. Des médicaments et des pharmaciens pour l'armée, 1800-1815. Histoire des sciences médicales. 2014, XLVIII, n°3, 305-316.