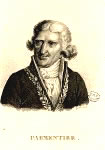
Antoine Augustin Parmentier (1737-1813).
Le plus illustre des pharmaciens militaires français est né le 12 août 1737 à Montdidier en Picardie dans une famille modeste d'un père drapier. Il est baptisé le jour même à l'église du Saint Sépultre. Ses parents sont Jean-Baptiste Parmentier et Marie-Euphrosine Millon. Son père âgé de 25 ans et sa mère 31 ans. Il fait son apprentissage dès 13 ans dans la pharmacie d'un apothicaire de sa ville natale la pharmacie Frison à Montdidier, puis le continue à 18 ans à Paris en 1855 chez Jean-Antoine Simonnet.
A 20 ans, en 1757, sans fortune pour s'installer, il veut entrer dans le corps des apothicaire des armées sur les conseils de Simonnet. Il passe devant un examinateur, Louis Claude Cadet de Gassicourt qui est apothicaire major de l'hôtel des Invalides depuis quatre années
Devenu militaire, il stationne avec les blessés dans la ville de Hanovre comme pharmacien de troisième classe dans les annexes du palais du roi d'angleterre transformé pour les circonstances en hôpital et magasins des armées. Il devient pharmacien de deuxième classe. Pendant la guerre de Sept Ans notamment lorsqu'ils auraient été faits prisonniers ensemble à Rossbach qu'il fait la connaissance de Bayen: ce serait l’origine de l’amitié entre ces deux monuments de la pharmacie militaire. Parmentier est fait cinq fois prisonnier durant cette longue guerre mais il est échangé à chaque reprise. En juin 1760 Bayen le nomme pharmacien de première classe soit aide-major.
Au cours de sa dernière incarcération en Allemagne, il découvre la qualité nutritive d’un tubercule, une plante de la famille des Solanacées qui deviendra la pomme de terre, elle est destinée à l’alimentation des animaux et des prisonniers. Originaire d’Amérique du sud où les Incas la cultivaient sous le nom de "papa",l a pomme de terre arrive en Europe avec les conquistadores et en France elle est déjà cultivée particulièrement en Ardèche sous le nom de « truffoles » du fait de son caractère souterrain et de son aspect peu flatteur plus proche du précieux champignon que de la Bintje actuelle. Parmentier doit rester en captivité chez un apothicaire de Francfort, Mayer avec lequel il sympathise tellement que Mayer lui propose sa fille en mariage car le jeune picard n'étant pas insensible aux charmes de la jeune personne avec son laboratoire-officine et la nationalité prussienne. Parmentier refuse le tout pour "je dois rentrer, je n'ai encore rien accompli pour ma patrie".
À son retour de captivité à la fin de la guerre le 10 février 1763, il a 26 ans. Il bénéficie des enseignements de trois savants, l'abbé Nollet, professeur de physique expérimentale, Guillaume Rouelle, chimiste de renom et Bernard de Jussieu, l'éminent botaniste.
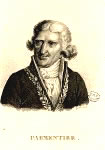
.

En 1772, son mémoire sur la pomme de terre obtient le premier prix de l'académie de Besançon. Les membres de la Faculté médecine de Paris qui planchaient depuis longtemps sur le sujet finissent par déclarer que la consommation de la pomme de terre ne présente pas de danger car il existe une interdiction du Parlement de la cultiver datant de 1748. La pomme de terre comme la tomate a probablement subi la mauvaise réputation de leur famille, celle des Solanacées, qui compte dans ses rangs des membres moins recommandables comme la belladone, la jusquiame ou la mandragore.
Il passe sa maîtrise le 28 mai 1774 après ses six années passées aux Invalides. Fervent catholique, il ne sera pas franc-maçon malgré les sollicitations de ses amis, préférant garder son indépendance. Mais le roi Louis XVI lui retire sa charge à sa demande le 29 juillet 1774 sous les coups des sœurs grises et de la cabale ecclésiastique qu’elles avaient savamment organisée pour retrouver leurs prérogatives dans le domaine pharmaceutique en faisant appel au roi lui-même. Il y garde un appartement que sa soeur entretient, mais doit laisser ses plantations de pomme de terre aux Invalides, le terrain appartenant aux religieuses. Parmentier rédige en 1779 un mémoire qui le rend célèbre : Examen critique de la pomme de terre. Le 6 juin de cette même année sous l'influence de Bayen, il est nommé apothicaire-major des hôpitaux de la division du Havre et de Bretagne, poste qu'il occupera deux ans. Il sera souvent dans ces régions et en profitera pour promouvoir la culture de la pomme de terre et la qualité du pain.
Pugnace, il va promouvoir la pomme de terre en organisant des dîners où seront servis différents plats à base de pomme de terre et où sont conviés des hôtes prestigieux tels que Benjamin Franklin ou Lavoisier, véritables opérations promotionnelles au principe encore d’actualité. Avec l’appui de Louis XVI, il crée en 1786 une plantation de deux arpents (1 hectare) à Neuilly dans la plaine sablonneuse des Sablons réputée inculte (métro Sablons). Le fait de pouvoir y cultiver un quelconque végétal est un véritable pari surtout que les difficultés s'accumulent : retard dans la plantation et manque de pluie. Il apporte au roi le 24 août 1786 de cette année, veille de la Saint Louis, un bouquet de fleurs de pomme de terre : le roi en glisse une à sa boutonnière et une autre sur la perruque de Marie-Antoinette. L’utilisation novatrice de la publicité royale popularise la pomme de terre. La récolte des Sablons est bonne, 520 boisseaux (6 m3): devant ce succès la surface cultivée passe à 37 arpents (20 hectares).
Ultérieurement, sur un autre terrain à Gentilly où il reprend la culture, les gardes des lieux selon la légende ont l’ordre de laisser la population « voler » ces plants Paris
précieux nécessitant leur garde ce qui permet de disséminer le tubercule. Il est plus probable qu'ils sont là pour éviter des vols de plants qui ne sont pas encore mûrs... En 1787 la pomme de terre est largement distribuée et cultivée dans tout le royaume, des variétés ont été sélectionnées. Trouvée insipide, Parmentier va se transformer en cuisinier afin de populariser des recettes la contenant " on en prépare des pâtés de légumes, des boulettes excellentes ; on les mange en salade, à l'étuvée, au roux, à la sauce blanche, avec la morue, en haricot, en friture et avec les gigots : on en farcit les dindons et les oies. Mais un moyen simple d'en faire un met délicat, sur le champs, c'est quand elles sont cuites et un peu rissolées à leur surface, de les ouvrir et d'y mettre du beurre frais, du sel et des petites herbes hachées...". Il adapte leur cuisson à la vapeur ce qui est un moyen de cuisson novateur.
La pomme de terre est aujourd'hui indispensable à l’alimentation avec 350 millions de tonnes produites actuellement. Ainsi l’année 2008 est déclarée « année internationale de la pomme de terre » par l’ONU afin qu’elle soit reconnue comme aliment de base pour la population mondiale. Mais à la fin du XVIII siècle, la pénurie alimentaire exacerbée par le blocus naval anglais est le principal problème de la population.
Parmentier met toute son énergie pour nourrir le peuple en s’intéressant à la valeur nutritive et à la fabrication de produits de substitution. Il propose ainsi le sucre de raisin et de betterave pour le sucre de canne cultivé en Amérique et la culture du maïs pour remplacer celle de blé déficitaire. Il fait de nombreuses études et ouvrages sur le sucre de raisin mais c'est celui de betterave dont la production sera choisie par Napoléon. Il s’intéresse aussi à la valeur nutritive et la conservation des farines, du vin et des produits laitiers.
En 1778 il publie son «Traité complet sur la fabrication du pain» et "le parfait boulanger". Avec son ami Louis Cadet de Vaux, il va améliorer la qualité du pain distribué dans les hôpitaux, les prisons et les armées en imaginant une nouvelle méthode de panification. En juin 1780, il fonde avec Cadet de Vaux une école de boulangerie à Paris en uniformisant les composants et les techniques de fabrication qui seront sans doute à l’origine de la qualité et de la réputation internationale du pain français. "propager par la voie de l'enseignement les lumières d'un art aussi utile que la boulangerie ce n'est pas seulement travailler pour les générations présentes, c'est songer au bonheur des générations futures".
Il publie aussi sur l’intérêt alimentaire du maïs, des fourrages, du blé, des champignons, mais aussi sur le vin, les eaux de boisson, les eaux-de-vie et la salubrité dans les hôpitaux militaires, il participe aux débuts de l’hygiène hospitalière. Il travaille sur l’opium et l’ergot de seigle.
De 1779 à 1781 , durant la guerre maritime de la France et de l'Angleterre, il est aux hôpitaux de la division rassemblée au Havre et sur les côtes de Bretagne. En 1782, il est avec l'armée chargée de rétablir l'ordre dans Genève et en 1788 il est présent au camp de Saint-Omer.
De 1781 à 1792, il est l'adjoint de Bayen au Conseil de Santé et de 1792 jusqu'à son décès, il reste l'un des membres les plus actifs de ce Conseil.
Le soutien de Louis XVI à l'agronome philanthrope le rend d'abord suspect au nouveau régime révolutionnaire, mais rapidement lui sont confiées la surveillance des salaisons destinées à la Marine et la fabrication des biscuits de mer, nourriture essentielle dans la Royale, puis le Directoire, le Consulat et l'Empire utilisent largement ses multiples compétences qui sont très variées.
Il est Inspecteur général du service de santé de 1803 jusqu’à sa mort en 1813.
Parmentier avait une personnalité attachante, jointe à une grande compétence. Jacob est très impressionné lor Le 16 octobre 1766, Parmentier obtient sur concours ce qui est une première la charge d’apothicaire de l’Hôtel royal des Invalides avec un salaire de 300 livres annuelles et dont il deviendra le pharmacien en chef en 1772. Il y est sous la coupe peu amène des sœurs dites de la Charité qui avaient le pouvoir, sinon la connaissance, de préparer et d’administrer les médicaments, responsabilité qu’elles ne voulaient pas partager. Parmentier ne peut que noter les prescriptions. Il en profite pour continuer ses analyses dans son laboratoire et ses recherches agronomiques notamment sur la pomme de terre dont il sélectionne progressivement les meilleures variétés. Il étudie notamment, en ces temps de famine ou de disette, l'intérêt de l'amidon de pomme de terre et sa capacité de remplacer la farine de blé en proposant du pain et du gâteau de pomme de terre.
s de sa visite au camp de Montreuil en 1804, il avait alors 67 ans, et il le décrit ainsi très admiratif et respectueux "C'était un vieillard bien conservé auquel des traits réguliers, de beaux cheveux blancs, donnaient un air tout à fait vénérable. Son accueil avait quelque chose d'affectueux et de bon ; sa bouche était gracieuse et sa voix agréable. Un physique aussi majestueux joint à une grande réputation de savant et à la qualité de membre de l'Institut m'en imposèrent extrêmement : je me trouvais heureux et fier d'avoir à servir sous un chef réunissant d'aussi belles qualités".
ainsi très admiratif et respectueux "C'était un vieillard bien conservé auquel des traits réguliers, de beaux cheveux blancs, donnaient un air tout à fait vénérable. Son accueil avait quelque chose d'affectueux et de bon ; sa bouche était gracieuse et sa voix agréable. Un physique aussi majestueux joint à une grande réputation de savant et à la qualité de membre de l'Institut m'en imposèrent extrêmement : je me trouvais heureux et fier d'avoir à servir sous un chef réunissant d'aussi belles qualités".
Il fait adopter la vaccination antivariolique par l’armée et s’occupe des conditions d’hygiène sur les bateaux. Il devient le premier président de la Société de pharmacie de Paris puis devient président du Conseil de salubrité de Paris en 1807. Il préconise la conservation des viandes par le froid et il travaille sur l’amélioration de la technique des conserves alimentaires par ébullition mis au point par Nicolas Appert.
Très attaché à son titre de pharmacien, il définit lui-même sa vie et son œuvre exemplaire « mes recherches n’ont d’autres but que le progrès de l’art et le bien général. La nourriture du peuple est ma sollicitude, mon vœux est d’en améliorer la qualité et d’en diminuer le prix. J’ai écrit pour être utile à tous. Si nous avons adopté la pharmacie, restons lui fidèles, ne rougissons pas de son nom, forçons même par des talents et des vertus nos collègues les médecins et les chirurgiens, à abjurer pour toujours la vaine et méprisable dispute des préséances, à reconnaître que la première place appartient au plus habile, et qu’on ne doit traiter de subalternes que la sottise et l’ignorance».
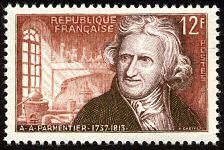 Le nombre d’articles et d’ouvrages dont il est l’auteur et qui sont donnés en annexe, fait de ses «titres et travaux» un vaste ensemble très impressionnant.
Le nombre d’articles et d’ouvrages dont il est l’auteur et qui sont donnés en annexe, fait de ses «titres et travaux» un vaste ensemble très impressionnant.
Il travaille jusqu'à sa mort d'une pneumonie à 76 ans, le 17 décembre 1813.
Parmentier est un homme universellement connu, un "honnête homme", qui a consacré soixante année de sa vie à un exercice professionnel exemplaire et très varié essentiellement voué aux autres.
Il est resté fidèle à la pharmacie militaire et à sa reconnaissance par les autres profession de santé militaire comme en témoigne cette citation :
« si nous avons adopté la pharmacie, restons lui fidèles, ne rougissons pas de son nom, forçons même par des talents et des vertus nos collègues les médecins et les chirurgiens, à abjurer pour toujours la vaine et méprisable dispute des préséances, à reconnaître que la première place appartient au plus habile, et qu’on ne doit traiter de subalternes que la sottise et l’ignorance".
Son caractère exceptionnel est ainsi dominé par le travail, les sciences, la probité et la rigueur" Ses conceptions étaient rapides, son âme expansive et brûlante, il ne voyait avec indifférence rien de ce qui intéressait l'humanité".
Il a apporté le meilleur de lui même dans l'art pharmaceutique, la salubrité publique, la prophylaxie, l'alimentation du peuple et des armées sans oublier l'organisation des hôpitaux. Il a aussi apporté une contribution majeure dans l'accroissement du niveau de santé et de vie des français et des peuples qui lui doivent une reconnaissance éternelle.
Références
A Balland. Les pharmaciens militaires. 1913.
Anne Muratori-Philip. Parmentier. Plon editeur. 2006.
Cadet de Gassicourt C. Eloge d'AA Parmentier. Société de pharmacie de Paris. 1814.
Olivier Lafont. Parmentier au-delà de la pomme de terre. Pharmathèmes éd. 2013.
http://www.napoleonicsociety.com/french/riaudparmentier.ht.ml
http://santerre.baillet.org/communes/montdidier/v2b/v2b4c02b54.php